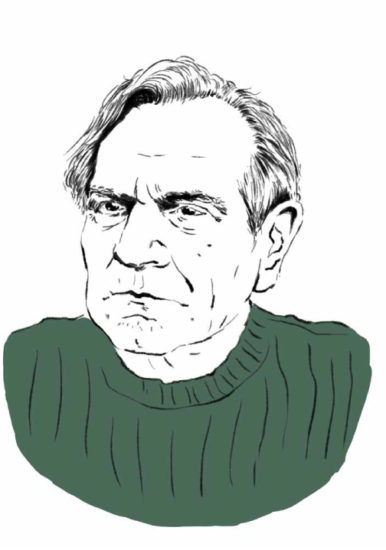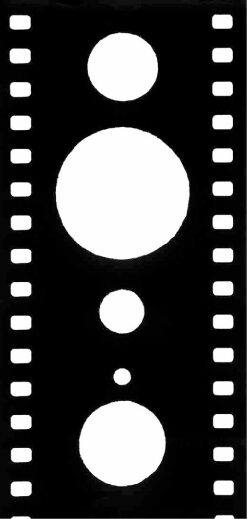Conversation avec Józef Robakowski
Interview, The Eyes #7
15/11/2018
L’Image par dessus tout
Interview de Józef Robakowski par Amaury Chardeau et Klaudia Podsiadlo
Illustration de Mélanie Roubineau
Né en 1939, Józef Robakowski est l’une des figures majeures de la « néo » avant-garde polonaise apparue dans les années 1960. Cinéaste, photographe, enseignant, collectionneur, cet artiste questionne inlassablement les frontières de l’expression visuelle. À l’heure où la Pologne s’apprête à célébrer le centenaire de ses pionniers, il revient pour The Eyes sur ses recherches artistiques et sur les soubresauts politiques qui les ont vu naître.
Laquelle de vos photos raconterait vos origines ?
Jozef Robakowski : Je ne pense pas à une de mes images, mais plutôt à des albums photo de ma famille. C’était de vieux albums de la fin du xixe, richement ornés. Mon père les avait constitués à partir de photos qu’il prenait des siens. Riche propriétaire terrien issu de la noblesse, officier dans l’armée polonaise, il vivait avec sa femme dans la campagne au nord de Varsovie. Très peu de temps après ma naissance, en septembre 1939, il a été tué dans les combats contre les nazis.
Ma mère nous a élevés seule, mon frère et moi, mais en 1944, après la prise de pouvoir par les communistes, une réforme agraire a ordonné la collectivisation des grandes exploitations. C’était une période très violente marquée par de nombreux pillages. Je devais avoir quatre ans : je revois des soldats russes ou des paysans du coin pénétrer chez nous, et repartir avec notre bétail, nos outils agricoles… Nous avons dû quitter notre propriété pour une errance de plusieurs années. Parmi les objets que ma mère a pu emporter se trouvait l’un de ces albums photo. Elle me l’a transmis et j’y tiens énormément. Bien plus tard, devenu artiste, j’ai utilisé cet album dans le cadre d’une exposition à Varsovie afin de rappeler la mémoire de cette noblesse d’avant-guerre qui avait été complètement rayée de l’histoire officielle. Un musée d’art contemporain m’a récemment proposé de refaire une installation à ce sujet. J’ai alors été contacté par une femme qui se trouvait être la fille de mon ancienne nourrice. Elle m’a renvoyé certains des objets qui nous avaient été volés, dont un autre de nos albums photo, mais dont toutes les images ont été arrachées.
Cette histoire vous a façonné ?
Oui, j’ai tout de suite compris que je ne pouvais pas soutenir le régime communiste. Pour moi, l’histoire de la Pologne s’arrêtait avec la Seconde Guerre mondiale. C’est ce que nous transmettaient nos professeurs en histoire de l’art à Toruń. La plupart venaient de Vilnius, qui a été annexée par les Soviétiques. Ils prônaient un statut de l’art débarrassé de sa fonction matérialiste. En cela, ils nous protégeaient de l’idéologie communiste. C’est sur cette conception de « l’art pour l’art » que nous, étudiants, avons commencé à travailler en créant le collectif Zéro 61. Il s’agissait de contester l’idéologie ambiante, de produire des photographies sans nous soucier de la réalité de l’époque ou de la philosophie matérialiste que le socialisme voulait nous imposer. Nous n’avions pas accès aux lieux d’expositions officiels ou aux galeries. Nous investissions clandestinement des lieux, nous faisions nous-mêmes nos catalogues et ainsi, nous pouvions échapper à la censure. C’était très underground.
Quels étaient les courants artistiques qui vous influençaient ? On pense au dadaïsme…
Oui, bien sûr. À l’école de Toruń, nous avions à disposition une bibliothèque extraordinaire où nous pouvions consulter toutes sortes de livres sur le surréalisme, l’art abstrait ou le dadaïsme… C’était une chance exceptionnelle, car à l’époque, la presse ne montrait rien de l’art occidental, à peine parfois une reproduction de Cézanne ou de Pissarro… Il faut se souvenir que, jusqu’en 1958, il était impossible de trouver en Pologne le moindre livre d’art sur l’art occidental. Nos modèles étaient les artistes polonais du début du siècle, Witold Wojtkiewicz, Stanislaw Ignacy Witkiewicz, Stanislaw Wyspianski… Ça n’avait rien à voir avec les goûts de l’époque.
Après vos études en histoire de l’art, vous intégrez l’école de cinéma de Lodz qui est très réputée et qui deviendra l’une des plus importantes d’Europe…
Oui, je pratiquais déjà le cinéma depuis quelques années. Après avoir été recalé une fois, car on avait jugé mes photos trop abstraites, j’ai été admis à l’école en 1966. Mon passage là-bas a été décisif. C’était un carrefour entre l’Est et l’Ouest, réunissant parmi les professeurs de très grands pédagogues russes, mais aussi des étudiants talentueux, comme Roman Polanski ou Jerzy Skolimowski. Ces derniers avaient déjà réalisé leurs premiers chefs-d’œuvre, que ce soit Deux hommes et une armoire pour Polanski ou Signe particulier : néant pour Skolimowski. C’était le lieu idéal pour réfléchir à ce qu’était l’art contemporain, et un souffle salutaire dans la Pologne d’alors ! Comment avez-vous trouvé votre style ?
Je souhaitais me démarquer du cinéma « socialiste », mais aussi du romantisme, fondé sur la littérature, qui imprégnait beaucoup le cinéma polonais de l’époque, comme chez Kieslowski ou Wajda. L’école de Lodz possédait des archives très riches de films d’avant-guerre. J’y ai retrouvé un film inédit de Stefan et Franciszka Themerson, ce couple de pionniers du cinéma expérimental qui a travaillé dès les années 1920. Et puis un jour, dans les réserves du musée d’art de Lodz, je suis tombé sur des photomontages réalisés par plusieurs photographes de l’entre-deux- guerres. Ça m’a ouvert de nouveaux horizons.
Je voulais me distinguer, au risque de m’aliéner le milieu des cinéastes polonais. Je voulais revenir à une certaine pureté du cinéma, d’où ce manifeste que j’ai publié en 1971, intitulé « Encore une fois du cinéma pur ». Il s’agissait de revenir aux principes du cinéma des années 1920, mais à l’aune de la conscience que nous avions de notre propre époque. De produire un cinéma débarrassé de toute influence littéraire et qui se focaliserait plutôt sur une dimension plastique, volontairement abstraite, dans le son comme dans l’image. Nous avons donc commencé à observer Lodz, à travers nos caméras, avec l’envie de représenter la ville et son identité, parfois de manière décalée, voire absurde.
Un peu comme dans Market, ce court-métrage que vous réalisez en 1970 et qui montre, dans un très long plan fixe accéléré au montage, une foule évoluant toute une journée sur un marché ?
Exactement. L’idée de ce film m’était venue à l’occasion de voyages réguliers à Moscou. J’étais alors familier de l’œuvre de Dziga Vertov, du constructivisme russe, mais également du constructivisme polonais. Soudain, nous commencions à nous inspirer davantage de l’art de l’Est que de celui de l’Ouest.
Par la suite, vous prendrez souvent la ville et ses habitants comme objets d’étude…
Oui, en 1973, par exemple, nous avons fait une installation pour le musée d’art moderne de Lodz. Ça s’appelait Action atelier. Grâce à l’un des enseignants de l’école, qui était aussi directeur d’une antenne de la télévision, nous avons pu bénéficier de moyens professionnels, notamment d’un car-régie. Nous avions donc installé trois caméras : devant le musée, dans l’atelier d’un menuisier et dans l’appartement d’une famille, et pendant toute une journée, nous avons retransmis dans le musée la vie qui se déroulait dans ces trois endroits. C’était une démarche pionnière et aussi un exploit technique pour des étudiants. À cette époque, je pense, que cela n’aurait pu être réalisé nulle part ailleurs.
Et puis il y a From my window, ce projet que vous menez sur plus de vingt ans entre 1978 et 2000, en filmant la rue depuis votre appartement. Il en résulte dans la durée une sorte de fresque de l’effondrement du communisme…
Je vivais alors dans un quartier de Lodz qui s’appelait « Manhattan », ce qui paraît ironique vu que mon immeuble ressemblait davantage à une tour HLM ! Je voulais dépasser le cinéma analytique et filmer cette ville à la manière d’un reportage, tout en y injectant mon vécu, mais aussi ma voix qui commentait les choses. Commencé en 16 mm, le tournage s’est poursuivi en vidéo. Au final, c’est un journal de la transformation de la ville depuis le communisme jusqu’au capitalisme. C’est ce que j’appelle mon « cinéma personnel », celui que je poursuis encore aujourd’hui et qui fait écho à l’évolution de ce pays…
À ce propos, quel regard portez-vous sur l’évolution politique actuelle de la Pologne, et notamment vis-à-vis de la culture ?