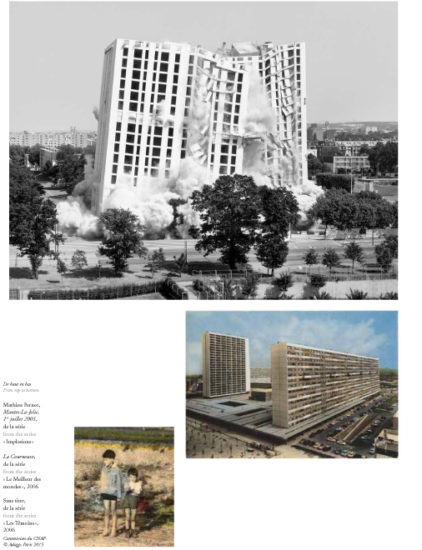SCÉNOGRAPHIES DE L’ILLUSION
The Eyes #5
15/11/2018
Scénographies de l’illusion
Texte par Dominique Baqué
La mise à l’honneur de Paris nous offre l’occasion d’interroger la photo- graphie française contemporaine. Ne serait-ce pas autour de la question du document et de la supposée véracité de ce que représente l’image, qu’elle se manifeste le mieux aujourd’hui ? Dominique Baqué nous conduit à la rencontre d’un courant réflexif et peut-être très français.